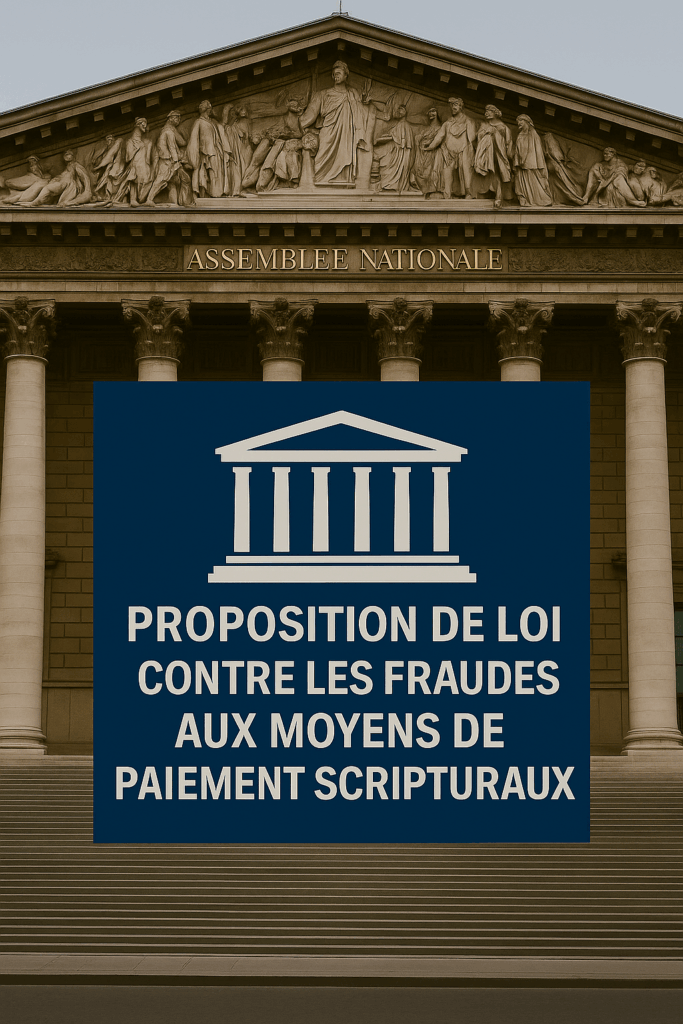Le 31 mars 2025, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi n° 884, déposée le 4 février 2025 par plusieurs députés. Face à la recrudescence des fraudes, l’objectif est de renforcer les dispositifs de prévention et de détection concernant les moyens de paiement scripturaux, tels que les virements, les prélèvements, les chèques et les cartes bancaires. Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de mobilisation contre la fraude. Parmi les actions notables, figurent le plan de lutte contre les fraudes fiscales et douanières présenté par Gabriel Attal en 2023, ainsi que la proposition de loi récemment examinée par le Sénat, portant sur la lutte contre la fraude aux aides publiques.
En 2023, les fraudes aux moyens de paiement scripturaux ont causé des pertes estimées à près de 1,2 milliard d’euros pour l’économie française. Parmi ces infractions, les escroqueries aux faux IBAN ont généré plus de 149 millions d’euros de préjudice, tandis que la fraude au chèque demeure une menace majeure avec des montants dépassant les 490 millions d’euros. Ces chiffres témoignent de l’ampleur croissante des risques pesant sur les transactions scripturales, malgré les avancées technologiques en matière de sécurité.
La présente proposition de loi s’articule autour de trois articles clés :
- Article 1 : Création d’un fichier national des IBAN douteux
Ce premier article de la proposition de loi prévoit la mise en place d’un fichier national recensant les IBAN associés à des tentatives ou faits avérés de fraude. Géré par la Banque de France, ce fichier sera accessible aux prestataires de services de paiement (PSP), notamment les banques, qui pourront le consulter avant l’exécution d’un virement bancaire, mais également à la Caisse des Dépôts, au Trésor public et à la Banque de France.
Ce fichier national anticipe la révision de la deuxième Directive européenne sur les services de paiement (DSP2), qui envisage la mise en place d’un mécanisme de partage des données relatives à la fraude entre les prestataires de services de paiement à l’échelle de l’Union européenne. Ce dispositif vise à mieux prévenir les fraudes par manipulation, qui ont fortement augmenté avec le développement de l’authentification forte dans le cadre de la directive européenne DSP2. Désormais, les fraudeurs contournent les protections techniques en manipulant directement les victimes, par exemple en leur faisant modifier un IBAN pour détourner un paiement.
Grâce à ce fichier, les établissements financiers seront en mesure de détecter et bloquer les transactions suspectes avant leur exécution, en identifiant les IBAN signalés dans des cas de fraude précédents.
La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sera compétente concernant les mesures réglementaires relatives à la gestion de ce fichier (modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données du fichier, tarifs applicables, mise en place et fonctionnement du dispositif…)
Le texte précise les obligations des prestataires de services de paiement en matière d’alimentation du fichier (mise à jour en continu, précision des motifs justifiant la déclaration dans le fichier), tout en excluant la possibilité pour un titulaire de compte d’être informé de l’inscription de son IBAN dans le fichier.
- Article 2 : Extension du Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI)
Le deuxième article renforce la lutte contre la fraude aux chèques avec l’inclusion des chèques falsifiés (modification d’un chèque authentique) ou contrefaits (création de faux chèques) dans le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), géré par la Banque de France.
Jusqu’à présent, cette inclusion reposait uniquement sur l’arrêté du 24 juillet 1992, qui encadrait de manière réglementaire la centralisation des données relatives aux faux chèques.
La proposition de loi vient donc donner une base législative explicite à cette pratique, en l’inscrivant directement dans le Code monétaire et financier (article L.131-84), ce qui renforce la portée juridique du FNCI et consolide son rôle en matière de prévention.
Les prestataires de services de paiement auront l’obligation de signaler à la Banque de France, sous un certain délai que cette dernière imposera, tout rejet d’un chèque ou d’une formule de chèque falsifié ou contrefait, que ce soit lors du dépôt ou à posteriori, dès la détection d’une anomalie. Cette réactivité permettra une mise à jour rapide du FNCI et une meilleure prévention des fraudes.
Contrairement au Fichier Central des Chèques (FCC), qui recense les personnes interdites d’émission, le FNCI ne sera accessible qu’à certains acteurs : les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi qu’à la commission de surendettement et aux autorités judiciaires.
-
Article 3 : Accès des banquiers présentateurs au FNCI
L’article 3 de la proposition de loi ouvre la possibilité aux prestataires de services de paiement de consulter la Banque de France afin de vérifier la régularité d’un chèque au moment même de sa présentation par le client. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des encaissements en permettant une détection plus précoce des chèques frauduleux ou irréguliers.
Actuellement, selon l’article L. 131-86 du Code monétaire et financier, seuls les professionnels bénéficiaires d’un chèque peuvent consulter le Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI) via le service VERIFIANCE, fourni par la Banque de France. Ce service payant leur permet de s’assurer qu’un chèque n’a pas fait l’objet d’une opposition pour vol, perte ou usage frauduleux. Toutes les consultations du FNCI sont tracées : l’identité de la personne ou entité à l’origine de la demande est enregistrée afin d’assurer la traçabilité des accès au fichier.
La proposition de loi prévoit d’étendre cette faculté aux banquiers, en leur permettant, au moment du dépôt d’un chèque par un client, de consulter le FNCI pour vérifier si le chèque est irrégulier (volé, falsifié, ou en opposition). En cas de doute, l’encaissement du chèque pourra être différé jusqu’à confirmation du rejet définitif par la banque du payeur. L’objectif est d’éviter que des chèques déjà signalés comme frauduleux ne soient crédités, même temporairement, sur le compte d’un client.
Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, la proposition de loi est actuellement en cours d’examen au Sénat. Si elle est adoptée par ce dernier, elle pourrait entrer en vigueur rapidement et marquer une étape décisive dans la modernisation du cadre juridique applicable aux paiements scripturaux.
Sources :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0884_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_fin/l17b1153_rapport-fond